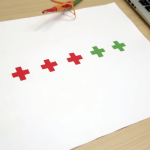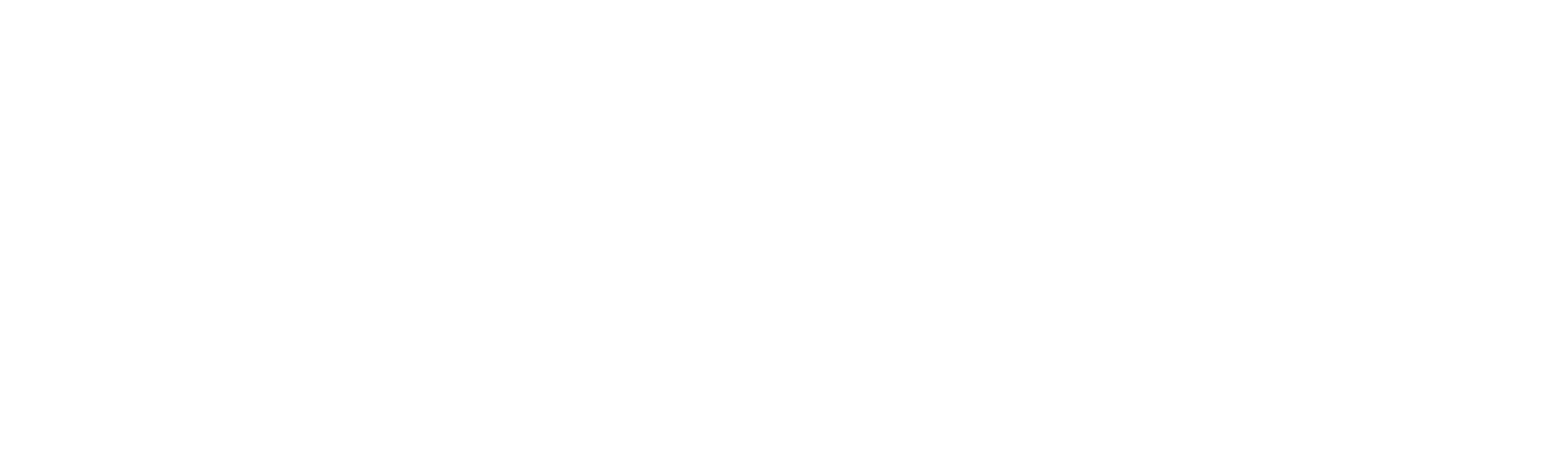L’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale : quelles différences ?
Article rédigé par Garance GONNET PRINCE, juriste PI à l’APP.
Temps de lecture : 5mn| Propriété Intellectuelle
Il n’est pas forcément évident de faire la différence entre action en contrefaçon et action en concurrence déloyale. Il s’agit pourtant bien de deux actions parfaitement distinctes. Mais alors, quels actes sont concernés ? Qui peut agir ? Quelles preuves peuvent être apportées ? Et enfin quelles sanctions peuvent être prononcées ?
La distinction entre les notions de contrefaçon et de concurrence déloyale
- La contrefaçon désigne uniquement l’atteinte à un droit de propriété intellectuelle. On parle de contrefaçon lorsqu’un tiers exploite un droit de propriété intellectuelle sans autorisation du titulaire de ce droit.
Ainsi, la reproduction, l’utilisation ou l’imitation d’une création protégée par un droit de propriété intellectuelle, sans l’autorisation du titulaire de ce droit, sont des actes de contrefaçon. La détention, la vente ou l’importation de produits contrefaits sont quant à elles assimilées à des actes de contrefaçon.
- La concurrence déloyale vise de façon plus générale l’ensemble des procédés déloyaux utilisés pour détourner la clientèle d’un concurrent. Il n’y a pas d’atteinte portée à un monopole d’exploitation.
On regroupe habituellement les pratiques de concurrence déloyale en quatre catégories :
- La confusion
La confusion désigne les manœuvres d’un opérateur économique qui cherche à acquérir la notoriété d’un concurrent en s’appropriant ou en imitant les signes distinctifs de ce concurrent, de ses produits ou de ses services afin de rallier sa clientèle. On parle de confusion s’il y a dans l’esprit du public une assimilation erronée des deux entités.
- Le parasitisme
Le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un concurrent en profitant indûment de sa notoriété ou de ses investissements, et ce indépendamment de tout risque de confusion.
- Le dénigrement
Le dénigrement renvoie à toute affirmation malveillante qui est dirigée publiquement contre un concurrent à l’égard de ses produits, de ses services ou de sa société elle-même. Pour qu’il y ait dénigrement, il faut impérativement que l’affirmation soit péjorative et publique. De plus, il faut que le concurrent visé soit identifiable.
En revanche, il n’est pas nécessaire que le concurrent visé soit un concurrent direct agissant dans le même secteur d’activité que l’auteur des propos.
- La désorganisation
La désorganisation désigne les actions d’un opérateur économique qui bouleverse l’organisation d’un concurrent ou d’un marché économique sur lequel il opère.
Cela peut par exemple consister à déstabiliser un concurrent en débauchant massivement ses salariés.
L’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale
L’action en concurrence déloyale et l’action en contrefaçon ne sont pas ouvertes exactement aux mêmes personnes et ne réparent pas le même préjudice.
L’action en contrefaçon repose sur un fondement spécifique lié à l’atteinte portée à un droit de propriété intellectuelle. L’action en concurrence déloyale, elle, repose sur le droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
- L’action en contrefaçon est une action attitrée. Cela signifie qu’il ne suffit pas d’avoir un intérêt à agir, il faut avoir une qualité particulière. En l’occurrence, être le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle (sauf cas particulier du licencié).
En outre, il faut bien entendu que le droit de propriété intellectuelle soit en vigueur au moment de l’atteinte.
- L’action en concurrence déloyale est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime à agir. Il faut démontrer l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre cette faute et ce dommage (même en l’absence de relation contractuelle entre l’auteur des actes déloyaux et son concurrent).
L’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale sont souvent invoquées simultanément au cours d’une même instance. Si le juge reconnait des faits distincts, alors il sera possible d’obtenir une condamnation sur chacun de ces deux fondements.
Il est par ailleurs possible que le juge rejette la qualification de contrefaçon mais condamne l’auteur de l’atteinte au titre de la concurrence déloyale.
En revanche, l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ne peuvent en aucun cas aboutir à réparer deux fois le même préjudice.
Les moyens de preuve
La preuve des actes de contrefaçon et des pratiques de concurrence déloyale peut être apportée par tous moyens. La charge de la preuve incombe au demandeur. Et le juge ne peut évidemment pas statuer sur les faits qui ne sont pas invoqués par les parties.
La preuve sera souvent un document écrit sur support électronique ou papier. Mais il peut aussi s’agir de captures d’écran, d’enregistrements sonores, d’attestations de témoins, de rapports d’experts…
La nature de la preuve n’importe pas, en revanche toute preuve doit avoir été recueillie de manière loyale. Une preuve ne doit pas avoir été obtenue par la fraude, la violence ou le vol. A titre d’exemple, les enregistrements audio ou vidéo sans consentement ne sont pas considérés comme des preuves loyales.
En pratique, il est très commun de recourir au constat d’huissier. Les huissiers de justice peuvent être commis par justice ou à la requête de particuliers pour effectuer des constatations. Ces constatations doivent être purement matérielles, ce qui signifie que l’huissier n’a pas à donner un quelconque avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter.
Aussi, il est régulièrement nécessaire d’effectuer des constats en ligne. L’APP propose à cet effet une solution de constat en ligne automatique qui permet de constituer une preuve numérique fiable, sécurisée et horodatée. Cette solution a une valeur probante élevée et conforme à la norme NF Z67-147. Elle offre la possibilité d’effectuer ses propres constats en ligne de manière autonome en se connectant à distance sur une plateforme sécurisée et en accédant à un navigateur internet dédié.
Enfin, il existe une procédure spécifiquement dédiée à l’obtention de preuves d’actes de contrefaçon : la saisie-contrefaçon.
La saisie-contrefaçon se fait sur requête (c’est-à-dire qu’il n’y a pas de contradictoire).
Cette procédure a une finalité de preuve mais aussi de saisie des stocks. Ce n’est cependant pas une mesure d’interdiction. Par conséquent, le défendeur qui subit une saisie-contrefaçon peut parfaitement poursuivre son activité (sauf s’il y a en parallèle une mesure d’interdiction provisoire).
Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut faire procéder en tout lieu et par tous huissiers :
– soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, du logiciel prétendument contrefaisant (ainsi que de tout document s’y rapportant),
– soit à la saisie réelle du logiciel prétendument contrefaisant (ainsi que de tout document s’y rapportant).
En général, le demandeur doit garantir qu’il pourra assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est par la suite jugée non fondée ou la saisie annulée.
Enfin, le demandeur a l’obligation de se pourvoir au fond ou de déposer une plainte devant le procureur de la République suite à la saisie-contrefaçon (et ce dans un délai fixé par voie réglementaire). A défaut de quoi, l’intégralité de la saisie, y compris la description, peut être annulée sur simple demande du saisi.
Les peines encourues
Dans le cadre de l’action en contrefaçon comme dans celui de l’action en concurrence déloyale, le juge peut octroyer à la victime des dommages et intérêts. Il fixe le montant en fonction du préjudice subi.
Le juge peut également ordonner la cessation des pratiques déloyales et/ou des actes de contrefaçon.
Par ailleurs, l’action en contrefaçon peut aussi entrainer des sanctions pénales. L’auteur d’actes de contrefaçon risque jusqu’à trois ans de prison et 300 000 € d’amende. Ces sanctions augmentent en cas de circonstances aggravantes (par exemple : délit en bande organisée, récidive…).
Enfin, le juge peut aussi ordonner des peines comme la confiscation voire la destruction des produits saisis, la publication du jugement, l’interdiction d’exercer une activité commerciale pendant un certain temps ou même la fermeture de l’établissement.
Vous avez aimé l’article ?
N’hésitez pas à le partager et à nous suivre sur nos réseaux sociaux pour en apprendre plus