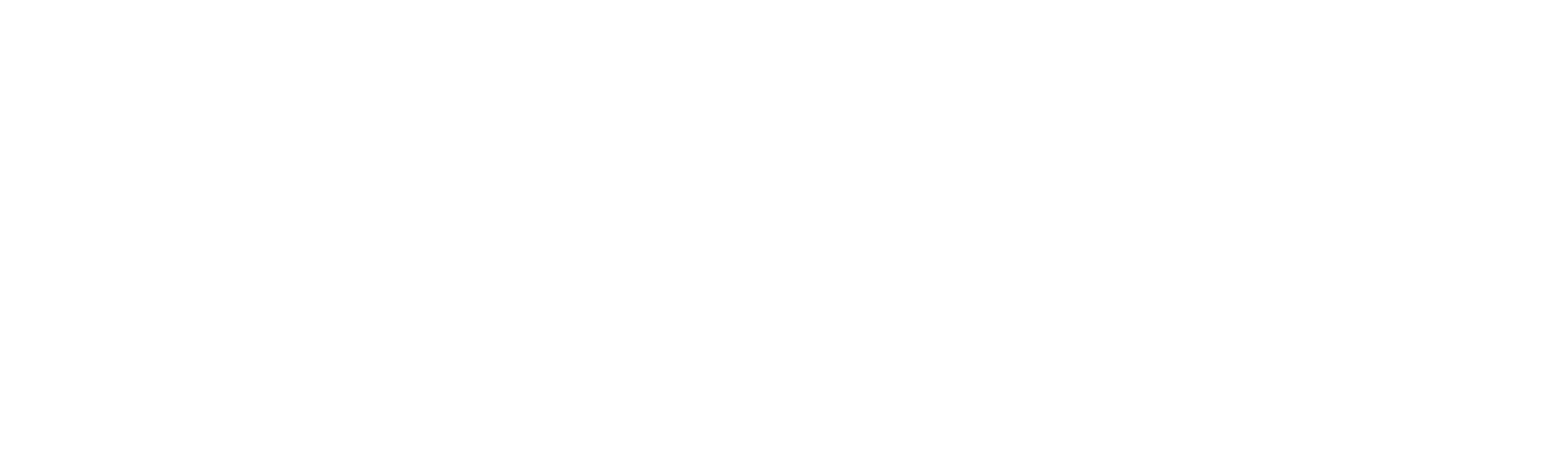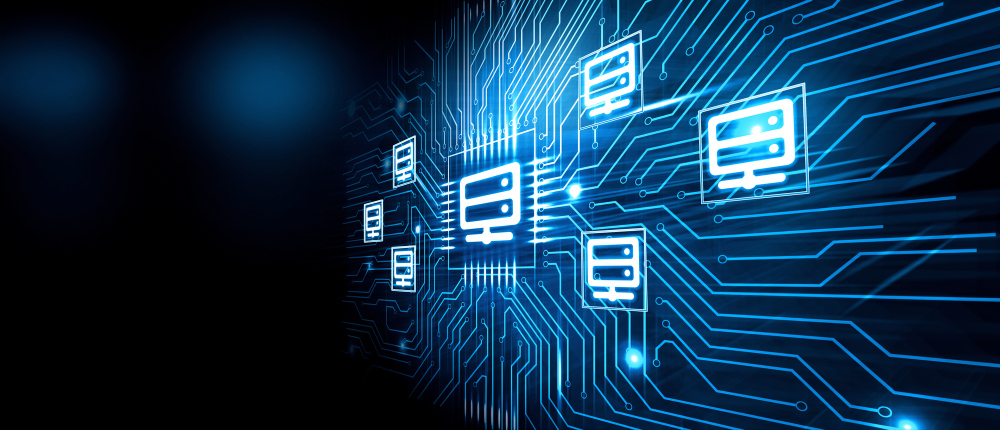
Valoriser et protéger les bases de données : une nécessité stratégique
Gaëtan LASSERE
Temps de lecture : 5mn| Base de données
La propriété intellectuelle à l’ère du numérique
La propriété intellectuelle (PI) désigne l’ensemble des droits exclusifs accordés sur des créations de l’esprit. Elle englobe notamment le droit d’auteur, les brevets, les marques, les dessins et modèles.
Pour rappel, les droits de propriété intellectuelle peuvent naître d’un dépôt, ou ils peuvent naître différemment. Dans le premier cas, la protection découle d’un enregistrement auprès d’une autorité compétente, après un examen formel. Cela concerne notamment les brevets, marques, dessins et modèles, qui bénéficient alors d’une présomption de validité. Dans le second cas, les droits naissent automatiquement, sans formalité, comme c’est le cas pour le droit d’auteur ou le droit sui generis sur les bases de données. Toutefois, leur protection juridique repose sur la capacité à en prouver la matérialité à une date certaine.
Dans un contexte d’innovation numérique accélérée, de développement massif de l’intelligence artificielle et de multiplication des litiges (scraping, piratage, etc.), les entreprises doivent penser leurs actifs immatériels autrement. Les codes sources, bases de données, interfaces et algorithmes sont plus que de simples outils : ce sont des actifs stratégiques.
Protéger ces actifs, c’est leur donner une sécurité juridique. Cela signifie leur conférer un statut valorisable, défendable et exploitable dans le cadre de levées de fonds, de négociations commerciales ou d’actions en contrefaçon.
Pourtant, les bases de données, en particulier, restent souvent mal protégées, faute d’anticipation, de documentation, ou de compréhension juridique.
Le webinaire coanimé par l’Agence pour la Protection des Programmes et Gaëtan Lassere, CPI brevet chez Ipsilon et mandataire OEB, apporte un éclairage concret et technique sur la protection des bases de données par les différents droits à notre disposition.
Droit d’auteur : comment prouver l’originalité d’un code source ?
En droit français, le droit d’auteur peut protéger les codes sources à condition que sa structuration ou son écriture reflète une empreinte personnelle de l’auteur : une originalité. Toutefois, la jurisprudence récente se montre de plus en plus exigeante quant à la démonstration de cette originalité. La simple création ou possession du code ne suffit plus : il faut désormais établir en quoi la manière d’écrire ou de structurer le code révèle une démarche créative, laissant transparaître la personnalité de l’auteur.
En théorie, si deux informaticiens devaient coder une même fonction, ils adopteraient chacun une approche différente. Cela traduirait alors une forme de subjectivité, laissant entrevoir leur personnalité dans la construction du code. Les choix opérés doivent ainsi dépasser les seules contraintes logiques ou techniques, pour manifester un apport propre, révélateur de l’empreinte de leurs auteurs.
L’affaire Conex c/ Tracing est intéressante à cet égard. Elle illustre que le juge commence par apprécier l’originalité du code source, avant même de se pencher sur la contrefaçon de celui-ci. Ensuite, la décision met en lumière les éléments de preuve recevables pour démontrer l’originalité.
Pour une protection efficace, outre des dépôts d’horodatage (APP), il est vivement recommandé de documenter l’originalité des codes sources dès leurs développements. En effet, plusieurs mois, voire des années, peuvent s’écouler entre sa conception et un éventuel litige. Il devient alors difficile, voire impossible, de reconstituer a posteriori les éléments démontrant l’originalité de la création. Néanmoins, ce réflexe de documentation précoce et continue demeure encore trop rare dans la pratique.
Droit sui generis : transformer l’investissement en droit
Le droit sui generis constitue un régime autonome de protection. Il trouve son origine dans la directive européenne 96/9/CE du 11 mars 1996 relative à la protection juridique des bases de données. Transposée en droit français aux articles L.341-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, cette directive a institué un droit spécifique au bénéfice du producteur de base de données.
Le droit sui generis confère au producteur le droit d’interdire, sans autorisation, l’extraction et/ou la réutilisation de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu de la base de données. Cette protection est valable pour une durée de 15 ans à compter de la date d’achèvement de la base. Elle peut être renouvelée à chaque nouvel investissement substantiel. Cela permet une protection potentiellement continue dans le temps, tant que le producteur maintien des investissements.
Toutefois, pour bénéficier de cette protection, il est impératif de pouvoir démontrer l’existence d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel voire, le cas échéant, un préjudice subi. Cela souligne l’importance stratégique de documenter rigoureusement les efforts et ressources mobilisés, tant lors de la conception initiale de la base que lors de ses éventuelles mises à jour. Là encore une recherche rétrospective s’avère particulièrement difficile et fragile si cette documentation n’a pas été constituée en temps réel.
Bases de données et droit sui generis : explorer les jurisprudences pour mieux comprendre vos droits
CJUE – CV Online Latvia – 3 juin 2021
CV Online Latvia, une plateforme de recherche d’emploi, a vu son contenu partiellement extrait par Melons, un site disposant d’un moteur de recherche dont les liens hypertextes redirigeaient vers le site de CV Online. Malgré cette extraction, aucun préjudice n’a été reconnu, car CV Online restait l’intermédiaire principal entre les utilisateurs.
Cette jurisprudence européenne, restrictive, induit la nécessité d’une preuve double : d’un investissement substantiel dans la base de données et d’un préjudice économique réel pour engager une action en contrefaçon au titre du droit sui generis.
On peut ainsi s’interroger si cette décision ne constitue pas un nouveau coup d’arrêt pour l’effectivité de la protection conférée par ce droit sui generis.
La Centrale c/ Ads4All – 8 juillet 2021
Dans cette affaire, Ads4ALL a procédé à l’extraction et à la réutilisation d’une partie substantielle, voire de la totalité, de la base de données de La Centrale, spécialisée dans les annonces automobiles. Cette opération avait pour but d’attirer les internautes vers le site d’Ads4ALL, au détriment de celui de La Centrale. Une fois les clients captés, ils étaient ensuite redirigés vers le site de La Centrale pour la phase de négociation.
De son côté, La Centrale a démontré que son modèle économique reposait principalement sur la publicité affichée lors de la consultation directe de ses annonces. En privant la plateforme de ce trafic, Ads4ALL compromettait donc une source essentielle de revenus.
Le juge a reconnu l’existence d’un préjudice économique, malgré le maintien de la redirection vers le site d’origine, et a sanctionné Ads4ALL pour extraction et réutilisation illicites de la base de données.
LeBonCoin c/ Entreparticuliers.com – 5 octobre 2022
L’une des jurisprudences les plus emblématiques en France en matière de droit sui generis concerne la base de données immobilière du site LeBonCoin. Dans cette affaire, la société Entreparticuliers.com avait mis en place un système d’extraction automatique des annonces immobilières publiées sur la plateforme LeBonCoin.
Ce dernier est parvenu à démontrer un investissement substantiel dans la constitution et la vérification de sa base de données. Il a notamment apporté la preuve de l’intervention de plusieurs équipes techniques internes, du recours à des prestataires extérieurs chargés de contrôler la conformité des annonces, ainsi que d’un investissement significatif en matière de publicité visant à attirer les utilisateurs et alimenter la base.
Par un arrêt du 5 octobre 2022, la Cour de cassation a reconnu l’existence d’un droit sui generis au profit du site LeBonCoin et a statué en sa faveur. La société Entreparticuliers.com a été condamnée à cesser l’extraction des données litigieuses et à indemniser le préjudice subi.
Décisions récentes (2025)
Lors de l’affaire Nestenn c/ Entreparticuliers.com, Nestenn a obtenu gain de cause le 30 janvier 2025. En effet, le juge a estimé que la simple captation des annonces constituait en soi un préjudice intrinsèque, justifiant la reconnaissance d’une atteinte aux droits du producteur de la base de données.
À l’inverse, dans l’affaire LeBonCoin c/ Directannonce, le litige s’est soldé par un échec pour LeBonCoin le 21 février 2025. Bien que l’investissement ait été reconnu, le préjudice n’a pas été établi. En effet, Directannonce existait avant la création du système de LeBonCoin, et son activité n’avait pas pour but de priver LeBonCoin de ses revenus ni de porter atteinte à son modèle économique. En conséquence, Directannonce n’a pas été sanctionné.
Entre précaution et action : construire une stratégie gagnante
À l’aune des dernières jurisprudences, qui rejettent souvent les preuves d’originalité et montrent une grande variabilité dans la reconnaissance de l’investissement, voire du préjudice, on constate une augmentation constante des critères et exigences. Il est possible d’apporter des preuves solides, mais alors il est indispensable de garantir leur précision et leur traçabilité. Pour cela, la méthodologie doit être rigoureuse, impliquant une documentation exhaustive, tant sur les volets techniques que juridiques.
In fine, cette démarche permet de valoriser les codes sources et les bases de données à deux niveaux. Premièrement, elle renforce leur protection en leur donnant une plus grande force juridique. Deuxièmement, elle facilite leur valorisation financière. Leur protection n’est plus une option, mais une exigence stratégique. Cette approche pluridisciplinaire permet à ces actifs numériques de devenir de véritables avantages concurrentiels.
Bibliographie
CJUE – CV Online Latvia : Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 3 juin 2021, Affaire C-762/19
La Centrale c/ Ads4All : Tribunal Judiciaire de Paris, 3e chambre 1re section, 8 juillet 2021
LeBonCoin c/ Entreparticuliers.com : 5 octobre 2022, Cour de cassation, Pourvoi n° 21-16.307, Première chambre civile – Formation de section, Publié au Bulletin
Nestenn c/ Entreparticuliers.com : Tribunal judiciaire de Paris , 3e ch., 1re sect., 30 janvier 2025, n° 22/01517
LeBonCoin c/ Directannonce : 21 février 2025 Tribunal judiciaire de Paris RG n° 21/09261 3ème chambre 2ème section
Vous avez aimé l’article ?
N’hésitez pas à le partager et à nous suivre sur nos réseaux sociaux pour en apprendre plus