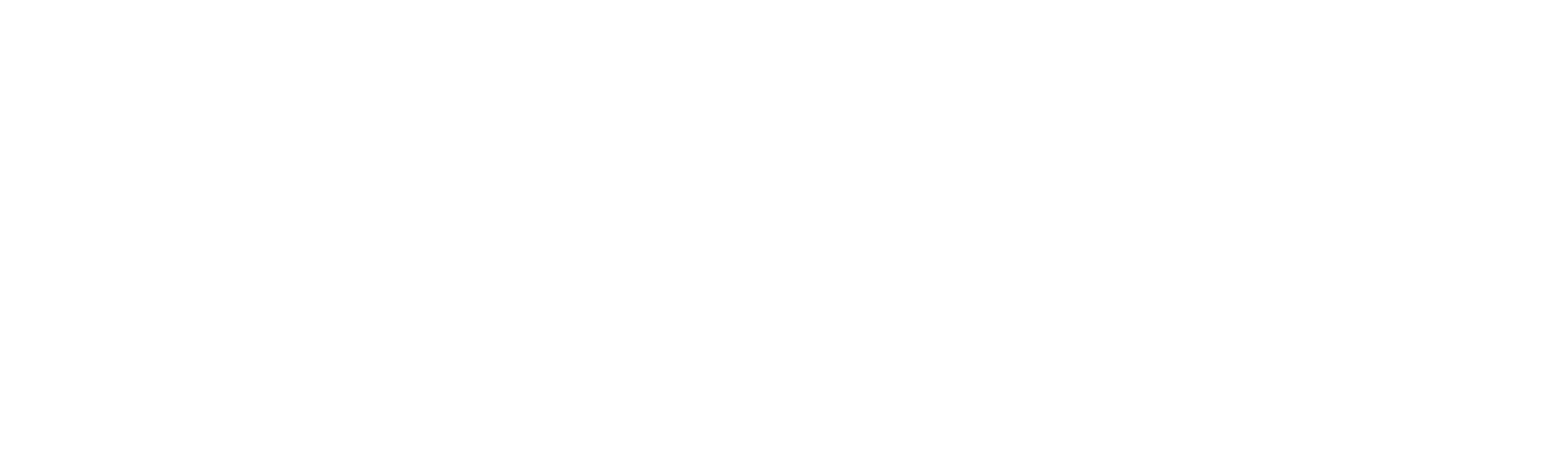Cession, licence et transfert de droit : tout comprendre
Article rédigé par Thomas CAVACECE
Temps de lecture : 3mn| Dépôt
La cession de droits consiste en un transfert total ou partiel des droits d’exploitation attachés à une œuvre numérique par son titulaire à une autre partie (physique ou morale).
La cession permet au cessionnaire d’utiliser, d’exploiter ou même de revendre l’œuvre numérique, selon les termes de l’accord.
Il convient de rappeler qu’un auteur dispose de deux catégories de droits sur son œuvre :
- Les droits moraux
- Les droits patrimoniaux
Les droits moraux, liés à la personnalité de l’auteur, sont inaliénables et perpétuels[1]. Ces droits incluent le droit de divulgation, le droit à la paternité de l’œuvre, le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre, ainsi que le droit de retrait et de repentir. Il convient de noter que dans le domaine du logiciel, certaines limitations peuvent s’appliquer à ces droits[2].
Les droits patrimoniaux, quant à eux, sont cessibles et limités dans le temps (70 ans après le décès de l’auteur[3]), ce qui permet leur monétisation. Ces droits concernent principalement les droits de représentation et de reproduction[4]. Dans le domaine du logiciel, ils comprennent, selon l’article L122-6 du Code de la propriété intellectuelle, la reproduction totale ou partielle, la traduction, l’adaptation, la modification et la mise sur le marché.
Il est donc essentiel de bien comprendre le fonctionnement de la cession de droits, les formalismes qu’elle implique, ainsi que son impact, notamment pour les membres de l’Agence pour la Protection des Programmes (APP).
La cession de droits
La cession à titre onéreux
Le législateur a instauré un formalisme strict pour la cession des droits d’auteur dans le but de protéger les créateurs d’œuvres.
Tout d’abord, la cession doit obligatoirement être formalisée par écrit[5]. Un accord oral ou par simple courrier ne saurait constituer une cession valide des droits.
Le contrat de cession doit impérativement comporter les éléments suivants :
- L’identification précise de l’œuvre ou des œuvres cédées ;
- L’étendue des droits cédés, notamment en matière de reproduction et de représentation ;
- La destination, c’est-à-dire les moyens et supports concernés ;
- Le territoire sur lequel les droits s’appliquent ;
- La durée de la cession.
Chacune de ces informations doit faire l’objet d’une mention distincte et clairement définie.
Le contrat doit également stipuler la contrepartie de la cession, c’est-à-dire la rémunération due à l’auteur, qui est soumise à des règles spécifiques.
Dans le cadre des œuvres logicielles, l’auteur peut se voir accorder une rémunération proportionnelle, bien que cela reste rare et difficile à mettre en œuvre. Dans la majorité des cas, la rémunération sera forfaitaire[6].
Il convient également de prévoir d’autres clauses, telles que la garantie d’éviction[7]. Le cédant doit s’assurer que le cessionnaire ne subira aucun trouble dans l’exploitation de l’œuvre. Ainsi, le cédant doit garantir qu’il est bien titulaire des droits cédés.
Enfin, le Code de la propriété intellectuelle interdit la cession d’œuvres futures[8]. L’œuvre cédée doit donc être déterminée ou, à tout le moins, déterminable.
La cession à titre gratuit
L’article L122-7 du Code de la propriété intellectuelle stipule que la cession des droits peut être effectuée à titre onéreux ou gratuit. Par conséquent, il est possible de prévoir une cession sans rémunération pour l’auteur.
Cependant, des décisions récentes de la jurisprudence ont introduit une certaine complexité en requalifiant ces cessions gratuites en donations[9]. Cette requalification a des conséquences importantes, car en vertu de l’article 931 du Code civil, les donations sont considérées comme nulles en l’absence d’un acte notarié.
Afin d’éviter cette formalité, il est possible de prévoir une rémunération minimale pour la cession. Les juridictions semblent, en outre, ne pas se concentrer sur l’adéquation de la rémunération par rapport à la valeur réelle de l’œuvre.
La cession automatique
Certaines situations entraînent une cession automatique des droits, sans qu’il soit nécessaire de conclure un contrat de cession distinct[10].
Dans le cadre d’un contrat de travail, la cession des droits intervient automatiquement, bien que le contrat puisse prévoir une rémunération spécifique pour cette cession. Ce principe s’applique également aux stagiaires et aux « personnes non visées par l’article L. 113-9, qui sont accueillies dans le cadre d’une convention par une personne morale de droit privé ou public dans un contexte de recherche. »[11]
En cas de cession, il est fortement recommandé de consulter un avocat afin de rédiger un contrat clair et adapté à vos besoins.
La licence
La licence ne constitue pas une cession à proprement parler, mais plutôt une « cession partielle » caractérisée par une limitation de l’étendue des droits accordés, de leur durée et de leur destination.
Dans ce cadre, le titulaire des droits accorde à un tiers un droit de reproduction restreint ainsi qu’un droit d’utilisation de son œuvre. Toutefois, ce tiers n’acquiert pas les droits sur l’œuvre, mais en devient simplement le licencié.
Le non-respect des stipulations contractuelles définies dans la licence peut entraîner non seulement des poursuites pour contrefaçon, mais également des actions sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Le transfert de droits
L’Agence pour la Protection des Programmes (APP) propose un service de dépôt probatoire qui permet d’établir l’existence de votre œuvre et d’assurer une date certaine. Ce service constitue une preuve déterminante pour la protection des droits et représente également un atout pour la valorisation des œuvres numériques.
Dans le cadre d’une cession de droits, d’une cession de fonds de commerce ou d’une fusion, nous offrons la possibilité de préserver cette preuve ainsi que la date certaine de sa création grâce à notre service de transfert de droits. Ce service facilite le transfert de la titularité d’une œuvre d’un membre à un autre membre.
L’APP accompagne cédant ou cessionnaire, membre actuel ou future dans le processus de changement de titulaire des droits.
Pour ce faire, il suffit de nous adresser un email à l’adresse app@app.asso.fr en précisant la demande. Il sera alors nécessaire de remplir un formulaire de transfert de droits et nous fournir les justificatifs attestant ce changement de titulaire (contrat de cession, accord de fusion, traité d’apport, TUP, etc.).et nous fournir les justificatifs attestant ce changement de titulaire (contrat de cession, accord de fusion, traité d’apport, TUP, etc.).
Une fois la procédure terminée, le cessionnaire sera reconnu comme le nouveau titulaire des droits et la date certaine d’antériorité de l’œuvre sera maintenue.
Conclusion
En conclusion, il est essentiel de souligner que la cession de droits doit se conformer à un formalisme rigoureux. Le contrat écrit doit impérativement préciser l’identification de l’œuvre, l’étendue des droits cédés, le territoire, la durée ainsi que la destination.
Si votre œuvre est enregistrée auprès de nos services, vous pourrez utiliser les informations figurant sur le certificat de dépôt pour en assurer une identification précise.
Il est donc fortement recommandé de consulter un avocat ainsi que nos services afin de garantir le respect de ce formalisme et de préserver la validité de vos dépôts.
[1] Article l121-1 du Code de la propriété intellectuelle
[2] Article l121-7 du Code de la propriété intellectuelle
[3] Article l123-1 du Code de la propriété intellectuelle
[4] Article l122-1 du Code de la propriété intellectuelle
[5] Article l131-2 du Code de la propriété intellectuelle
[6] Article l131-4 du Code de la propriété intellectuelle
[7] Article 1626 du Code civil
[8] Article l131-1 du Code de la propriété intellectuelle
[9] Cour d’Appel de Paris, 13 mars 2024, RG n°22/05440
[10] Article l113-9 du Code de la propriété intellectuelle
[11] Article l113-9-1 du Code de la propriété intellectuelle
Vous avez aimé l’article ?
N’hésitez pas à le partager et à nous suivre sur nos réseaux sociaux pour en apprendre plus